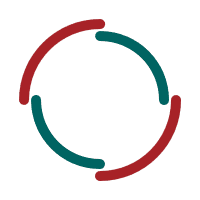Classification
- ClasseInsecta
- OrdreLepidoptera
- FamilleLycaenidae
- GenrePlebejus
- Espèceargus
- Nom scientifiquePlebejus argus
Cartes, phénologie, nombre de données, etc...
Carte de l'espèce
Morphologie
Envergure : 20-23 mm
L'Azuré de l'Ajonc est un joli petit papillon dont le dessus des ailes des mâles est d’un bleu légèrement violacé et présente une bordure marginale foncée d’environ un millimètre de largeur et des franges blanches. Les ailes postérieures sont ornées par des points marginaux internervuraux qui fusionnent avec la bordure. Les femelles, brunes, aux franges enfumées, sont rehaussées de lunules submarginales orangées et ne présentent que rarement un lavis basal bleu. Le revers est gris-bleuté chez le mâle, gris-brun chez la femelle, ourlé de bandes submarginales orangées rehaussées de points noirs pupillés de vert métallique. La bande blanche courant entre les points postdiscaux et submarginaux est peu marquée. Il est parfois diffi cile, sans capture, voire impossible sur une simple photographie, de différencier les trois espèces de Plebejus. Les critères suivant permettent de trancher dans la plupart des cas :
- P. argus : dessus des mâles bordé d’une large bande marginale. Femelles brunes, aux lunules orangées diffuses et peu arquées. Présence d’une épine à l’extrémité des tibias des pattes antérieures des mâles.
- P. idas : dessus des mâles bordé d’une bande marginale diffuse. Les ailes des femelles brunes, parfois suffusées de bleu, avec de belles lunules orangées formant d’amples arcs étirés vers la base. Au revers, ces lunules sont surmontées de chevrons noirs distinctement sagittés. Pas d’épine à l’extrémité des tibias des pattes antérieures des mâles.
- P. argyrognomon : plus grand, dépourvu de bande marginale chez le mâle. Femelles ornées d’une suffusion basale bleue plus ou moins étendue. Au revers, la rangée de taches orangées est coiffée d’arcs noirs doucement incurvés. Pas d’épine à l’extrémité des tibias des pattes antérieures.
Habitat
L’Azuré de l'Ajonc est une espèce méso-xérophile, dont les imagos peuvent parfois se rassembler en grand nombre dans les prairies et les clairières d’altitude, soit durant la journée pour s’abreuver au sol autour de suintements, soit le soir sur les hautes Graminées utilisées comme « dortoirs » jusqu’au lendemain. En plaine, il fréquente les bordures de pelouses, les friches en bas-de-versants, n’évoluant jamais très loin d’une source d’humidité auprès de laquelle il vient se désaltérer. Il se pose préférentiellement sur les chaumes des Graminées, tête en bas.
Reproduction
Le papillon vole de mai à début septembre. L'espèce est bivoltine en plaine, avec une génération vernale aux faibles effectifs, volant de la mi-mai à début juin, et une génération estivale davantage fournie, se montrant en juillet-août. Elle est probablement univoltine en juin-juillet au-dessus de 600 m. Les femelles sont très peu actives et pondent sur les Fabacées, avant tout sur le Lotier corniculé (Lotus corniculatus).
Régime alimentaire
Les adultes se nourrissent principalement du nectar des fleurs, les chenilles dévorent les plantes hôtes.
Relation avec l’homme
La déprise agricole de certaines stations des régions collinéennes et l’abandon du pâturage extensif a provoqué la fermeture des biotopes. L’Azuré de l'Ajonc n’y subsiste parfois que sur d’étroites ouvertures : un chemin herbu ou les bermes d’un fossé. Divers terrains militaires de manoeuvres en milieu marneux, qui jouaient jadis un rôle de refuge pour l’espèce à la faveur des ouvertures et des chemins, ont été désaffectés et sont désormais voués au retour à la forêt. L'espèce est considérée comme vulnérable en Bourgogne.
Réseau trophique
Les papillons sont les proies de nombreux insectivores, ils peuvent être consommés par d’autres insectes et des oiseaux par exemple. Comme c’est le cas pour les larves de beaucoup d’autres Azurés myrmécophiles, les fourmis prélèvent le miellat secrété par les chenilles.
Répartition géographique
Espèce eurasiatique, l’Azuré de l'Ajonc se raréfie dans tous les départements planitiaires de l’Ouest de la France. Assez fréquent en altitude, ce Lycène présente une distribution très dispersée à basse altitude en Franche-Comté, restreinte à quelques stations des plateaux saônois et de la frange jurassienne au-dessous de 500 m, où il se montre en petites colonies localisées, parfois sur quelques mètres carrés. Il est en revanche beaucoup plus répandu en altitude dans le massif du Jura, sur lequel il s’élève jusqu’à 1 000 m et même davantage. En Bourgogne, l’espèce est absente de la Nièvre et d’une grande partie occidentale de l’Yonne ; la plupart des populations ont périclité et les dernières stations de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire sont fortement menacées. Il est très faiblement représenté dans la Région par manque de biotopes adaptés.