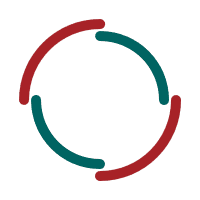Classification
- ClasseAmphibia
- OrdreAnura
- FamilleBufonidae
- GenreEpidalea
- Espècecalamita
- Nom scientifiqueEpidalea calamita
Cartes, phénologie, nombre de données, etc...
Carte de l'espèce
Morphologie
Taille : 4-8 cm
On le distingue facilement du Crapaud commun grâce à la ligne claire sur le dessus de son dos et à son iris jaune citron. Comme celui-ci, il est pourvu de grosses glandes produisant un venin en arrière des yeux, les glandes parotoïdes. Le dessus du corps est brun-gris pâle marbré de vert kaki, les pattes postérieures sont assez courtes.
Habitat
Le Crapaud calamite est un nomade ! On peut l’observer une ou quelques saisons à un endroit puis plus rien pendant des années… Avant que des individus ne se réinstallent peut-être à nouveau pour quelque temps. Espèce pionnière, il se déplace au gré de l’évolution des milieux aquatiques dans lesquels il pond. Lorsque l’instabilité de ses milieux est justement stable, de par l’action du bétail, des crues régulières, d’engins d’extraction de matériaux, les populations vont s’installer durablement. Si les facteurs perturbateurs qui lui sont indispensables disparaissent ou perdent de leur efficacité, il met les voiles ! Une étude a montré que, si la majorité des individus restent dans un rayon de quelques kilomètres autour de leurs sites principaux de ponte, certains peuvent migrer à plus de 10 kilomètres ! Il trouve des milieux de prédilection dans les carrières en exploitation, dans des prairies ou autres zones inondables des vallées, les queues d’étangs, ou dans des vieilles mares en voie d’atterrissement, dans les systèmes bocagers, les cultures ou parfois dans des zones périurbaines. Il sort surtout de nuit, par temps doux et humide. Dans tous les cas, les zones de ponte doivent être peu profondes et bien ensoleillées, comme des flaques et ornières. Fouisseurs, les adultes creusent des terriers dans les sols meubles, sableux, terreux ou argileux.
Reproduction
Au printemps, les chœurs des mâles, pourvus d’un imposant sac vocal sous la gorge, peuvent s’entendre à plus d’un kilomètre, ce qui facilite sa détection. Ces chants nuptiaux durent jusqu’en juillet, mettant en évidence une période de reproduction relativement longue au cours de laquelle plusieurs mâles peuvent frénétiquement tenter de saisir une femelle. Les pontes sont facilement confondues avec celles du Crapaud commun, elles ressemblent à de longs cordons pouvant rassembler 5 000 œufs enroulés parmi la végétation aquatique ou au fond de l’eau. L’éclosion rapide des œufs pourrait expliquer le faible nombre de signalements de pontes dans la Bourgogne Base Fauna. Les pontes s’étalent d’avril à août et il est possible que les femelles pondent deux fois dans la saison. Les larves grossissent vite et se métamorphosent en quelques semaines.
Régime alimentaire
Les adultes se nourrissent d’insectes et autres invertébrés (Arachnides, Crustacés…).
Relation avec l’homme
La fermeture et la destruction des milieux, les empoissonnements excessifs, la fragmentation des habitats entrainant un isolement des populations de Crapaud calamite et les assèchements de plus en plus rapides des points d’eau sont autant de menaces pour cette espèce en très forte régression dans plusieurs région d’Europe, protégée en France, déterminante ZNIEFF et « d'intérêt communautaire » à l'échelle européenne (inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore).
Réseau trophique
Le caractère temporaire de son milieu de reproduction permet au Crapaud calamite d’avoir peu de prédateurs aquatiques à l’état larvaire, la principale pression sur les adultes étant exercée par les oiseaux, des rapaces notamment. Les autres prédateurs sont les mêmes que ceux du Crapaud commun.
Répartition géographique
L’aire de répartition de ce Crapaud s’étend sur une grande partie de l’Europe. En France, sa répartition n’est pas homogène. Le Crapaud calamite est très rare en Bourgogne mais il est connu dans les quatre départements où il trouve ses principaux milieux de reproduction dans les zones inondables des vallées de la Loire et de la Saône. En Côte-d’Or, il est présent en vallée de la Tille, à la faveur notamment de gravières qui la parsème ; on signale quelques mentions en bord d’Ouche, en pays d’Arnay, dans le sud de l’Auxois, en Terre Plaine. Il semblait pénétrer en Morvan par l’est, au niveau de Saulieu, à la fin des années 1990, mais les stations connues à l’époque ne semblent désormais plus occupées.