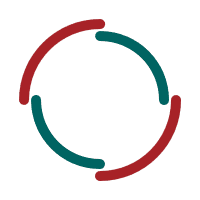Classification
- ClasseActinopterygii
- OrdreSalmoniformes
- FamilleSalmonidae
- GenreSalmo
- Espècesalar
- Nom scientifiqueSalmo salar
Cartes, phénologie, nombre de données, etc...
Carte de l'espèce
Morphologie
Taille : jusqu’à 130 cm, 2 à 10 kg
Le Saumon atlantique a un corps allongé couvert de petites écailles et une nageoire caudale échancrée. Les jeunes individus (appelés tacons puis smolts) ressemblent à la Truite commune : le dos est gris plus ou moins bleuté, les flancs sont argentés avec des marques bleutées, le ventre est blanc nacré. Les adultes ont une robe brillante argentée. Au moment de la reproduction, la peau s’épaissit et la robe prend une teinte jaune avec des taches rouges et pourpres ; un bec apparaît à la mâchoire inférieure des mâles.
Habitat
Cette espèce est migratrice. Les jeunes saumons vivent en eau douce pendant 1 à 2 ans en France (4 à 5 ans en Scandinavie). Ils sont alors territoriaux, uniquement fréquentant les zones courantes et peu profondes. Lors de leur deuxième ou troisième année, les poissons acquièrent progressivement des caractères morphologiques et comportementaux leur permettant de vivre en milieu marin. Ils vont alors dévaler vers la mer et rejoindre des zones de croissance situées au large des Îles Féroé et du Groenland. Après 1 à 3 étés passés en mer, ils regagnent les estuaires et remontent les fleuves pour atteindre les zones de reproduction.
Reproduction
Le Saumon atlantique se reproduit de novembre à janvier dans le même cours d’eau où il est né et que l’adulte retrouve grâce à son excellente mémoire olfactive. Bien que les populations soient propres à un cours d’eau, le brassage génétique existe avec des populations des rivières voisines. Le saumon remonte les cours d’eau et y pond dans les parties moyennes et supérieures, parfois à près de 1000 km de l’estuaire, dans des zones d’eau courante présentant un substrat de graviers et galets. La femelle émet 1500 à 1800 ovules de 57 mm par kilo. Les œufs éclosent en 2 à 3 semaines. Epuisés, la plupart des individus ne survivent pas à la reproduction.
Régime alimentaire
Les jeunes saumons consomment des larves d’insectes et des vers. Une fois adultes, les petits poissons et les crustacés (crevettes) constituent l’essentiel de leur nourriture : ce régime riche en caroténoïdes donne à la chair du saumon sa couleur rose caractéristique. Lorsqu’il revient en eau douce, le saumon adulte ne s’alimente pas et vit pendant plusieurs mois sur ses réserves.
Relation avec l’homme
De nombreuses menaces ont contribué à la régression de l’espèce en mer voire à sa disparition sur certains cours d’eau à partir du XIXe siècle. D’une part, la construction de barrages et seuils constituent des obstacles souvent infranchissables et bloquent l’accès aux frayères. D’autre part, le changement climatique provoque des modifications dans le comportement du saumon et dans ses conditions de vie, ce qui entraine une baisse du taux de survie en mer. Les pêcheries massives qui ont existé jusqu’au développement des productions aquacoles ainsi que la pollution de l’eau sont d’autres explications.
Aujourd’hui protégé en France, le Saumon atlantique est « d'intérêt communautaire » à l'échelle européenne (inscrit aux annexes II et V de la Directive Habitats-Faune-Flore), il est aussi évalué comme étant « vulnérable » sur les Listes rouges des espèces menacées en France et en Europe. Sa pêche est fortement règlementée sur le territoire et notamment interdite sur le bassin de la Loire depuis 1994 en raison du faible nombre d’individus. Grâce à des programmes de gestion se traduisant par des actions de reconquête des axes migratoires (suppression/aménagement des obstacles, protection des zones de frayères) et un soutien de certaine population par des alevinages le saumon reconquiert certains bassins.
Réseau trophique
Le saumon a peu de prédateur en France. En Amérique du Nord, il est notamment la proie des ours, des lynx et des loups.
Répartition géographique
Le Saumon atlantique fréquente la majorité des cours d’eau de l’Atlantique nord, ainsi que sur les littoraux Est (du Portugal au nord de la Scandinavie) et Ouest (Canada, Etats-Unis). Autrefois présent en Bourgogne sur les bassins de la Loire et de la Seine (frayères situées sur la Cure), il a fortement régressé voire disparu de nombreux cours d’eau : aujourd’hui on ne le trouve que sur la Loire où il se reproduit sur l’Arroux et des affluents dans le Morvan. Les principales zones d’engraissement se situent à l’ouest du Groenland, en mer du Labrador, en mer de Norvège et au nord des Îles Féroé.